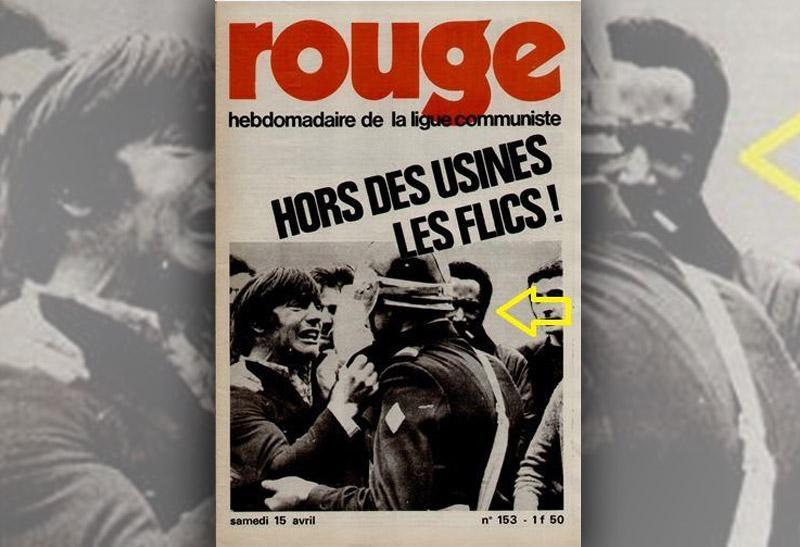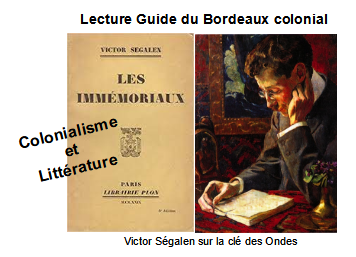Histoire de voir … histoires au pluriel
 24 octobre 2023 à 13h00 au 24 octobre 2025 à 14h00
24 octobre 2023 à 13h00 au 24 octobre 2025 à 14h00
Comment George Sand a failli se noyer dans la Gironde

Aurore de Saxe, Portrait de George Sand enfant, vers 1810. Pastel. Paris, musée de la Vie romantique.
Nous avons abordé les relations entre Flora Tristan et George Sand dans un précédent chapitre. Leurs relations ne furent pas trop amicales. Pourtant elles ont énormément de points communs. Lors d’une précédente déambulation sur Flora Tristan à Bordeaux, une participante nous a rappelé cette anecdote qui est arrivée à George Sand en Gironde. Elle, sa mère et son jeune frère Louis furent sauvés de la noyade par le père qui mourra accidentellement après le décès de son jeune frère.
Histoire racontées dans le livre HISTOIRE DE MA VIE par Mme GEORGE SAND. « Charité envers les autres ; Dignité envers soi-même ; Sincérité devant Dieu.
Telle est l’épigraphe du livre que j’entreprends. 15 avril 1847.
Et l’on découvre comment George (à l’anglaise sans s) Sand, du nom de son amant l’écrivain et dramaturge Jules Sandeau, plutôt de son vrai nom Amandine Aurore Lucile Dupin, née en 1804, à Paris a failli se noyer en arrivant d’Espagne dans l’estuaire de la Gironde.
C’est son père, Maurice Dupin de Francueil, un aristocrate descendant d’un roi de Pologne, militaire au service de la République puis de l’empereur pendant les guerres napoléoniennes, qui de retour avec femme Sophie Victoire Delaborde et ses enfants d’Espagne sauva leur vie dans l’estuaire de la Gironde.
La Guerre en Espagne
 Maurice Dupin est l’aide de camp de Joachim Murat en Espagne Arrivé depuis le mois de . Victoire, enceinte de sept mois, décide en avril de rejoindre son époux, accompagnée d’Aurore contre l’avis de ce dernier.
Maurice Dupin est l’aide de camp de Joachim Murat en Espagne Arrivé depuis le mois de . Victoire, enceinte de sept mois, décide en avril de rejoindre son époux, accompagnée d’Aurore contre l’avis de ce dernier.
Ils arrivent courant mai, après un voyage pénible. Le , le peuple madrilène s’était soulevé et les troupes françaises ont réprimé la révolte dans le sang. Les craintes de Maurice Dupin étaient justifiées. Son second enfant, un fils prénommé Auguste, naît à Madrid le , mais il est aveugle. Joachim Murat doit repartir pour l’Italie et accéder au trône de Naples.
Maurice obtient un congé pour rapatrier sa famille et espère guérir le nouveau né en France. Après l’avis favorable du médecin de l’Empereur qui s’est occupé de Victoire, Maurice reprend la route de Nohant avec sa femme et ses deux enfants. Il achète une calèche et les Dupin quittent Madrid dans la première quinzaine de juillet. Le voyage s’effectue lentement, sous une chaleur accablante et sur fond de guerre, car ils suivent les troupes de Murat qui se replient. Aurore et son petit frère ont la fièvre et la gale.

Maurice_Dupin_de_Francueil_(1778-1808) n uniforme d’officier de l’armée impériale.
Ils arrivent enfin au Berry dans les derniers jours d’août, chez la mère de Maurice Dupin. Une dispute éclate entre Victoire et Maurice qui lui reproche son voyage aberrant en Espagne malgré son désaveu : « Qu’y avait-il de plus téméraire et de plus insensé que de courir ainsi, grosse à pleine ceinture, à travers tant de dangers, de privations, de souffrances et de terreurs de tous les instants ? C’est un miracle que tu y aies résisté; c’est un miracle qu’Aurore soit vivante. Notre pauvre garçon n’eût peut-être pas été aveugle s’il était né à Paris ». Malheureusement, le bébé ne va pas survivre et meurt à Nohant-Vic, le . Une semaine plus tard, Maurice Dupin se tue accidentellement à cheval.
Ce sauvetage maritime n’empêcha pas peu de temps après la mort de son jeune frère (mort très jeune en juin 1808) précédant de celle de son père après une chute de cheval, laissant les deux femmes seules.
Les extraits relatant ces deux épisodes sont à retrouvés dans l’HISTOIRE DE MA VIE, publié par GEORGE SAND en 1847, la veille de la révolution de 48.
La famille se retire à Nohant après la naissance de Louis, né aveugle. « Ferdinand VII, le prince des Asturies, fait don de ce terrible cheval à mon père, l’indomptable Leopardo d’Andalousie à la suite d’une mission que celui-ci avait remplie, je crois, près de lui, à Aranjuez. »
Extrait 1 naufrage en Gironde
On est 1808 (p 51)

Sophie-Victoire DELABORDE mère de George Sand
» … Je ne sais quelle idée eut ma mère de vouloir retourner par mer à Bordeaux. Peut-être était-elle brisée par la fatigue de voitures, peut-être s’imaginait-elle, dans son instinct médical, qu’elle suivait toujours, que l’air de la mer délivrerait ses enfans et elle-même du poison de la pauvre Espagne.
Apparemment le temps était beau et l’Océan tranquille, car c’était une nouvelle imprudence que de se risquer en chaloupe sur les côtes de Gascogne, dans ce golfe de Biscaye toujours si agité. Quel que fût le motif, une chaloupe pontée fut louée, la calèche y fut descendue, et nous partîmes comme pour une partie de plaisir. Je ne sais où nous nous embarquâmes, ni quelles gens nous accompagnèrent jusqu’au rivage, en nous prodiguant de grands soins. On me donna un gros bouquet de roses, que je gardai tout le temps de la traversée pour me préserver de l’odeur du soufre.
Je ne sais combien de temps nous côtoyâmes le rivage ; je retombai dans mon sommeil léthargique, et cette traversée ne m’a laissé d’autres souvenirs que ceux du départ et de l’arrivée. Au moment où nous approchions de notre but, un coup de vent nous éloigna du rivage, et je vis le pilote et ses deux aides livrés à une grande anxiété. Ma mère recommença à avoir peur, mon père se mit à la manœuvre ; mais comme nous étions enfin entrés dans la Gironde, nous heurtâmes je ne sais quel récif, et l’eau commença à entrer dans la cale. On se dirigea précipitamment vers la rive, mais la cale se remplissait toujours, et la chaloupe sombrait visiblement. Ma mère, prenant ses enfans avec elle, était entrée dans la calèche ; mon père la rassurait en lui disant que nous avions le temps d’aborder avant d’être engloutis. Pourtant, le pont commençait à se mouiller, et il ôta son habit et prépara un châle pour attacher ses deux enfans sur son dos
« Sois tranquille, disait-il à ma mère, je te prendrai sous mon bras, je nagerai de l’autre, et je vous sauverai tous trois, sois-en sûre. » Nous touchâmes enfin la terre, ou plutôt un grand mur à pierres sèches surmonté d’un hangar. Il y avait, derrière ce hangar, quelques habitations, et, à l’instant même, plusieurs hommes vinrent à notre secours. Il était temps : la calèche sombrait aussi avec la chaloupe, et une échelle nous fut jetée fort à propos. Je ne sais ce qu’on fit pour sauver l’embarcation, mais il est certain qu’on en vint à bout ; cela dura plusieurs heures, pendant lesquelles ma mère ne voulut pas quitter le rivage ; car mon père, après nous avoir mises en sûreté, était redescendu sur la chaloupe pour sauver nos effets d’abord, et puis la voiture, et enfin la chaloupe. Je fus frappée alors de son courage, de sa promptitude et de sa force. Quelque expérimentés que fussent les matelots et les gens de l’endroit, ils admiraient l’adresse et la résolution de ce jeune officier qui, après avoir sauvé sa famille, ne voulait pas abandonner son patron avant d’avoir sauvé sa barque, et qui dirigeait tout ce petit sauvetage avec plus d’à-propos qu’eux-mêmes. Il est vrai qu’il avait fait son apprentissage au camp de Boulogne ; mais, en toutes choses, il agissait de sang-froid et avec une rare présence d’esprit. Il se servait de son sabre comme d’une hache ou d’un rasoir pour couper et tailler, et il avait pour ce sabre (probablement c’était le sabre africain dont il parle dans sa dernière lettre) un amour extraordinaire, car, dans le premier moment d’incertitude où nous nous étions trouvés en abordant, pour savoir si la chaloupe et la calèche sombreraient immédiatement, ou si nous aurions le temps de sauver quelque chose, ma mère avait voulu l’empêcher d’y redescendre, en lui disant : « Eh ! laisse aller tout ce que nous avons au fond de l’eau, plutôt que de risquer de te noyer ; » et il lui avait répondu : — « J’aimerais mieux risquer cela que d’abandonner mon sabre. » C’était, en effet, le premier objet qu’il eût retiré. Ma mère se tenait pour satisfaite d’avoir sa fille à ses côtés et son fils dans ses bras. Pour moi, j’avais sauvé mon bouquet de roses flétries avec le même amour que mon père avait mis à nous sauver tous. J’avais fait grande attention à ne pas le lâcher en sortant de la calèche à demi submergée et en grimpant à l’échelle de sauvetage.
C’était mon idée, comme celle de mon père était pour son sabre. »
Extrait 2 La mort du père
page 82
« … La nuit était sombre et pluvieuse, et j’ai déjà dit que ma grand’mère, quoique d’une belle et forte organisation, soit par faiblesse naturelle des jambes, soit par mollesse excessive dans sa première éducation, n’avait jamais pu marcher. Quand elle avait fait lentement le tour de son jardin, elle était accablée pour tout le jour. Elle n’avait marché qu’une fois en sa vie pour aller surprendre son fils à Passy en sortant de prison.
Elle marcha pour la seconde fois le 17 septembre 1808. Ce fut pour aller relever son cadavre à une lieue de la maison, à l’entrée de La Châtre. Elle partit seule, en petits souliers de prunelle, sans châle, comme elle se trouvait en ce moment-là. Comme il s’était passé un peu de temps avant qu’elle ne surprît dans la maison l’agitation qui l’avait avertie, Deschartres était arrivé avant elle. Il était déjà près de mon pauvre père ; il avait déjà constaté la mort.
Voici comment ce funeste accident était arrivé : Au sortir de la ville, cent pas après le pont qui en marque l’entrée, la route fait un angle. En cet endroit, au pied du treizième peuplier, on avait laissé, ce jour-là, un monceau de pierres et de gravats. Mon père avait pris le galop en quittant le pont. Il montait le fatal Leopardo. Weber, à cheval aussi, le suivait à dix pas en arrière. Au détour de la route, le cheval de mon père heurta le tas de pierres dans l’obscurité. Il ne s’abattit pas, mais, effrayé et stimulé sans doute par l’éperon, il se releva par un mouvement d’une telle violence, que le cavalier fut enlevé et alla tomber à dix pieds en arrière. Weber n’entendit que ces mots : « À moi, Weber !… je suis mort ! » Il trouva son maître étendu sur le dos. Il n’avait aucune blessure apparente ; mais il s’était rompu la colonne vertébrale. Il n’existait plus !
Je crois qu’on le porta dans l’auberge voisine et que des secours lui vinrent promptement de la ville, pendant que Weber, en proie à une inexprimable terreur, était venu au galop chercher Deschartres. Il n’était plus temps, mon père n’avait pas eu le temps de souffrir. Il n’avait eu que celui de se rendre compte de la mort subite et implacable qui venait le saisir au moment où sa carrière militaire s’ouvrait enfin devant lui brillante et sans obstacle, où, après une lutte de huit années, sa mère, sa femme et ses enfans, enfin acceptés les uns par les autres, et réunis sous le même toit, le combat terrible et douloureux de ses affections allait cesser et lui permettre d’être heureux.
Au lieu fatal, terme de sa course désespérée, ma pauvre grand’mère tomba comme suffoquée sur le corps de son fils. Saint-Jean s’était hâté de mettre les chevaux à la berline et il arriva pour y placer Deschartres, le cadavre et ma grand’mère, qui ne voulut pas s’en séparer. C’est Deschartres qui m’a raconté, dans la suite, cette nuit de désespoir, dont ma grand’mère n’a jamais pu parler. Il m’a dit que tout ce que l’âme humaine peut souffrir sans se briser, il l’avait souffert durant ce trajet où la pauvre mère, pâmée sur le corps de son fils, ne faisait entendre qu’un râle semblable à celui de l’agonie.
Je ne sais pas ce qui se passa jusqu’au moment où ma mère apprit cette effroyable nouvelle. Il était six heures du matin, et j’étais déjà levée. Ma mère s’habillait : elle avait une jupe et une camisole blanches, et elle se peignait. Je la vois encore au moment où Deschartres entra chez elle sans frapper, la figure si pâle et si bouleversée, que ma mère comprit tout de suite. « Maurice !
s’écria-t-elle ; où est Maurice ? » Deschartres ne pleurait pas. Il avait les dents serrées, il ne pouvait prononcer que des paroles entrecoupées : « Il est tombé….. non, n’y allez pas, restez ici… Pensez à votre fille… Oui, c’est grave, très grave…. » Et enfin, faisant un effort qui pouvait ressembler à une cruauté brutale, mais qui était tout à fait indépendant de la réflexion, il lui dit avec un accent que je n’oublierai de ma vie : « Il est mort ! » Puis il eut comme une espèce de rire convulsif, s’assit, et fondit en larmes.
Je vois encore dans quel endroit de la chambre nous étions. C’est celle que j’habite encore et dans laquelle j’écris le récit de cette lamentable histoire. Ma mère tomba sur une chaise derrière le lit. Je vois sa figure livide, ses grands cheveux noirs épars sur sa poitrine, ses bras nus que je couvrais de baisers ; j’entends ses cris déchirans. Elle était sourde aux miens et ne sentait pas mes caresses.
Deschartres lui dit : « Voyez donc cette enfant, et vivez pour elle. » Je ne sais plus ce qui se passa. Sans doute les cris et les larmes m’eurent bientôt brisée : l’enfance n’a pas la force de souffrir.
L’excès de la douleur et de l’épouvante m’anéantit et m’ôta le sentiment de tout ce qui se passait autour de moi. Je ne retrouve le souvenir qu’à dater de plusieurs jours après, lorsqu’on me mit des habits de deuil. Ce noir me fit une impression très vive. Je pleurai pour m’y soumettre ; j’avais porté cependant la robe et le voile noirs des Espagnoles, mais sans doute je n’avais jamais eu de bas noirs, car ces bas me causèrent une grande terreur. Je prétendis qu’on me mettait des jambes de mort, et il fallut que ma mère me montrât qu’elle en avait aussi. Je vis le même jour ma grand’mère, Deschartres, Hippolyte et toute la maison en deuil. Il fallut qu’on m’expliquât que c’était à cause de la mort de mon père, et je dis alors à ma mère une parole qui lui fit beaucoup de mal : Mon papa, lui dis-je, est donc encore mort aujourd’hui ?«
2021 Histoire de ma vie George Sand, édition Gerhard chapitre III p 51 87
 Aurore Dupin est née à Paris le 1er juillet 1804. Son père, Maurice Dupin, un militaire de carrière issu de la haute aristocratie, meurt en 1808 d’une chute de cheval à La Châtre (Indre) alors qu’elle a 4 ans.
Aurore Dupin est née à Paris le 1er juillet 1804. Son père, Maurice Dupin, un militaire de carrière issu de la haute aristocratie, meurt en 1808 d’une chute de cheval à La Châtre (Indre) alors qu’elle a 4 ans.
Sa mère, Sophie Delaborde, qui est issue quant à elle d’une famille modeste, vit à Paris et confie Aurore à sa grand-mère paternelle qui réside dans un petit château à Nohant (Indre).
Dès janvier 1818, Aurore, qui a 13 ans, devient pensionnaire au Couvent des Augustines anglaises à Paris. Elle rentre à Nohant en 1820.
Survient le décès de sa grand-mère le 26 décembre 1821, Aurore retourne alors vivre à Paris avec sa mère.
Le 17 septembre 1822, elle épouse, à l’âge de 18 ans, Casimir Dudevant (27 ans, fils naturel d’un baron d’Empire) à Paris. En octobre, ils partent s’installer à Nohant.
Le 30 juin 1823, elle met au monde un garçon prénommé Maurice. Cependant, le couple n’est pas heureux. Dès lors, elle a de nombreux amants: Aurélien de Sèze, Stéphane Ajasson de Grandsagne, Jules Sandeau (écrivain), Alfred de Musset (écrivain), Pagello (docteur), Michel de Bourges (avocat), Charles Didier, Bocage (acteur), Mallefille (le précepteur de Maurice), Frédéric Chopin (pianiste et compositeur), Alexandre Manceau (sculpteur), Marchal (peintre)…
Elle effectue également de multiples séjours: Pyrénées, Bordeaux, Auvergne, Lyon, Avignon, Marseille, Gênes, Pise, Florence, Venise, Milan, Chamonix, Suisse, Barcelone, Valldemosa (Majorque)…
Le 13 septembre 1828, elle met au monde son deuxième enfant Solange (qui serait la fille de Stéphane Ajasson de Grandsagne).
En 1830, elle rompt avec son mari (le divorce sera prononcé 6 ans plus tard) et part à Paris en compagnie de son amant Jules Sandeau, elle devient George Sand (elle choisit le prénom George pour affirmer symboliquement l’égalité des sexes). Elle mène une vie qui scandalise: elle s’habille en homme, elle fume la pipe et le cigare.
Elle perd sa mère le 19 août 1837.
Le 14 juillet 1863, elle devient grand-mère de Marc-Antoine qui mourra un an plus tard. Le 10 janvier 1866, elle devient à nouveau grand-mère, d’une petite Aurore.
La romancière est alors malade.
En mars 1868, elle est à nouveau grand-mère d’une petite Gabrielle.
Casimir Dudevant, son ex-mari s’éteint le 8 mars 1871.
George Sand meurt à Nohant le 8 juin 1876 à l’âge de 71 ans et est inhumée au cimetière de la commune deux jours plus tard.
![]() Ses livres
Ses livres
![]() Indiana (1832)
Indiana (1832)
![]() Valentine (1832)
Valentine (1832)
![]() Lélia (1833)
Lélia (1833)
![]() Jeanne (1836) (action située à Boussac)
Jeanne (1836) (action située à Boussac)
![]() La faute de Monsieur Antoine (1840) (action située à Crozant)
La faute de Monsieur Antoine (1840) (action située à Crozant)
![]() Le Compagnon du Tour de France-Consuelo (1842)
Le Compagnon du Tour de France-Consuelo (1842)
![]() Le Meunier d’Augibault (1845)
Le Meunier d’Augibault (1845)
![]() La Mare au diable (1846)
La Mare au diable (1846)
![]() François le Champi (1848)
François le Champi (1848)
![]() La Petite Fadette (1849)
La Petite Fadette (1849)
![]() Les Maîtres Sonneurs (1853)
Les Maîtres Sonneurs (1853)
![]() Histoire de ma vie (1854) (Autobiographie)
Histoire de ma vie (1854) (Autobiographie)
![]() Les Beaux Messieurs de Bois Doré (1858)
Les Beaux Messieurs de Bois Doré (1858)
![]() Mademoiselle de la Quintinie (1862)
Mademoiselle de la Quintinie (1862)
![]() Contes d’une grand-mère (1849-1876) (Pour ses petites-filles)
Contes d’une grand-mère (1849-1876) (Pour ses petites-filles)
- 1.Flora Tristan au Pérou : le capitaine Zacharie Chabrié
- 2.Flora Tristan au Pérou : qui était l’oncle Pio ?
- 3.Flora Tristan au Pérou : Pedro Mariano de Goyeneche et Barreda
- 4.Flora Tristan au Pérou : le colonel Bernardo Escudero
- 5.Flora Tristan au Pérou : Francisca Zubiaga la Maréchale
- 6.Flora Tristan au Pérou : 8 septembre 1833 – 15 juillet 1834
- 7.Flora Tristan et George Sand ?
- 8.George Sand a failli se noyer dans la Gironde en 1808
- 9.Flora Tristan l’histoire d’un tableau de et par Sandrine Daniel
- 10.Alfred Pierre Delboy, un républicain bordelais pendant la Commune …
- 11.Généalogie de Flora Tristan et d’André Chazal : la descendance
- 12.Aline Chazal Gauguin, la fille de Flora Tristan
- 13.A propos de Rosa Bonheur et de Flora Tristan
- 14.Une fin d’année bien chargée
- 15.Les séparées lecture théâtralisée
- 16.Marceline Desbordes Valmore à Bordeaux
- 17.Jasmin l’enchanteur, poète occitan
- 18.Exils d’hier et d’aujourd’hui
- 19.Hommage Flora Tristan 1844-2024
- 20.Hommage Flora Tristan 1844-2024